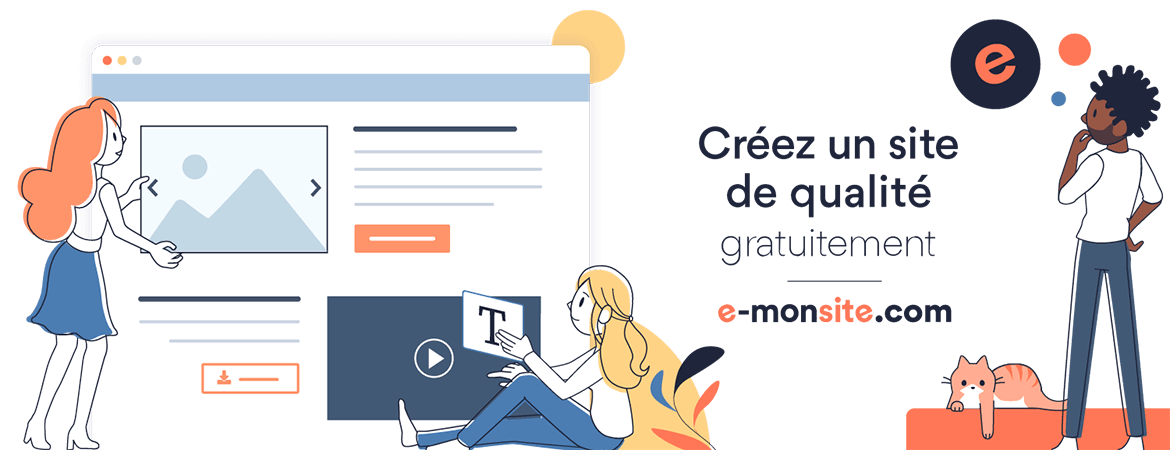L'harmonie et l'harmonisation
Article rédigé par Dhia Eddine Ben Youssef (chercheur, compositeur et professeur de musique)
L'harmonie...
Dès le commencement de la vie, la nature n’a jamais cessé d’engendrer une multitude d’éléments qui agissent entre eux, tout en subissant une influence sans cesse différenciée à chaque fois par d’autres éléments antécédents. Tous ces préceptes ne peuvent pas être identifiés par une simple définition proposée pour chaque constituant. Leur abondance, leur variété, et leur multitude innombrables empêchent en conséquence de réaliser ce genre d’identification. On peut même dire qu’ils établissent une infinité d’essences. On désigne par « éléments » toutes les choses et tous les objets, tous les phénomènes et toutes les scènes que peut provoquer la nature, et lesquels pourront procréer, à leur tour, de nouveaux constituants et de nouvelles matières. Ainsi, l’eau, source vitale de tout être vivant, agit sur la terre ; ce qui permet de métamorphoser l’état de cette dernière tout en gardant sa propriété. Par conséquent, celle-là se transforme en une surface verdoyante ; et les fleurs, ainsi que tout être végétal, fleurissent et prospèrent, ce qui génère une sorte de figure toute différente à celle qui a eu lieu auparavant. L’eau, à son tour, est susceptible de s’évaporer, ce qui nous pousse à parler alors d’un autre état de cette même eau. Un peu plus tard, et à partir de ce même élément, se déclencherait une autre existence, celle de la pluie, et ainsi de suite. La formation de ces éléments ne s’arrête jamais, tant que la vie est en train de se dérouler. Il faut prioritairement remarquer le sens large du mot « élément » qui est employé dans ce texte. Le changement d’état est également considéré comme changement de propriété.
Jusqu’ici, les mots sont assez générales, habituels, parfois banales. En fait, cette petite ouverture qui inaugure notre sujet peut laisser le lecteur confus en certains passages, voire même ennuyé. Cependant, une description efficace d’un fait aussi abstrait que celui de l’harmonie exige une intervention inévitable des fameux exemples tirés de la nature, qui reste désormais la source éternelle de l’inspiration humaine, ainsi que le large observatoire infini qui invite à méditer l’œuvre divine et à constituer par la suite nos propres sagesses à partir de toute la création. Ainsi, on ne peut jamais surpasser l’évocation des phénomènes « routiniers » qu’offre la nature depuis l’aube des jours, et qui présentent leur caractère perpétuel, faisant directement allusion à l’éternité. Comment pourrions-nous comprendre le naturel sans l’observer ?! Il serait bizarre et irrationnel de négliger la source de laquelle nous sommes. Je souligne bien le naturel, car l’harmonie est instinctivement naturelle. Elle doit toute sa définition constitutionnelle de la nature, et des phénomènes élémentaires engendrés par cette dernière. Elle est un fait purement sensitif, puisqu’il n’est pas décelable que par l’intermédiaire des sens.
Ce phénomène ne possède pas son contraire, ce qui implique que le mot « inharmonie » est complètement rejeté. L’unicité du premier, ainsi que sa largeur sémantique ne laissent aucune place au second, un mot pauvre et vague qui semble engendré par automaticité. Car, l’harmonie regroupe, elle seule, tous les éléments et toutes les conséquences que ces éléments sont supposés créer. Ce qui nous pousse à confirmer son omniprésence dans tous les états de la nature sans exception. Cela dit, il ne faut jamais prétendre que tous les aspects que pourrait acquérir toute forme de nature présente une harmonie. Il est vrai qu’elle s’enracine dans tous les phénomènes ; mais son attachement à chacun de ces phénomènes n’est pas toujours égal. Parfois, elle se présente sous la forme « cachée », parfois sous celle « éclatée », ou « timide ». Ces trois espèces que je suggère ne sont pas nécessairement uniques ou parfaitement justes. La diversité qui nous entoure de tous les côtés annule l’unicité de toute chose. De plus, la justesse ne pourrait être établie et confirmée que par la fine recherche du détail, et par l’analyse minutieuse qui, j’espère, mènent à une interprétation convenable de la vérité la plus convaincante.
... et l'harmonisation
La manière dont on parle de la musique de nos jours semble être assez sophistiquée et encombrée par l’intervention de plusieurs outils d’explication et d’interprétation du concept même de la musique. Cette nouvelle révolution a mis en cause presque la totalité des paramètres musicaux, à savoir les modes et les échelles, la technique et l’analyse, la forme et le genre, le signifiant et le signifié (on parle ici de la sémiotique de la musique). Parmi tous ces paramètres dont nous n’avons énoncés que les plus pertinents, on remarque bien que l’aspect polyphonique de n’importe quelle musique qui fait partie du monde est étudié et analysé d’une façon quasi comparative, et ceci par rapport à la musique occidentale que les musicologues la tiennent comme repère et modèle. Quand on parle de polyphonie, on parle automatiquement de l’éventuelle harmonisation d’une ou de plusieurs parties du discours mélodique d’une œuvre musicale donnée. Cette approche que l’on qualifie d’harmonique a fait l’objet de plusieurs études et travaux de recherche, dont les traités d’harmonie des temps anciens (en commençant par celui du compositeur et théoricien français J.-Ph. Rameau) et modernes (en contemplant celui du compositeur autrichien A. Schoenberg).
Entre temps, on remarque bien que l’étude harmonique d’un point de vue théorique passe immédiatement sous les mains des compositeurs et praticiens, et on trouve rarement d’exemples illustrant une théorie harmonique évidente conçue par un théoricien ou un profane à la composition musicale. Ceci nous montre que la formalisation conceptuelle et technique de l’harmonie reste toujours reliée à la concrétisation de l’idée à partir d’un facteur important dont le rôle dépasse celui de la création pour atteindre des stades de développement conceptuel énormes : la composition musicale. En effet, l’agrégation des accords et la gestion des lignes polyphoniques des différentes voix se voit concrétisé et palpable à travers une œuvre musicale. Et on n’oublie pas de mentionner que l’harmonisation dans la musique occidentale est absolument mélangée avec les outils de composition combinés ensemble ; c’est-à-dire le compositeur lui-même soigne, dans la plupart des cas, l’écriture et la conceptualisation de son œuvre tout en suggérant une construction harmonique et polyphonique adaptée spécialement à la mélodie qu’il a créée. Cette posture n’était pas reconnue dans les traditions compositionnelles de la musique orientale généralement, et la musique arabe particulièrement pendant très longtemps, vu que le langage modal et maqamique pourrait être donné sans avoir été harmonisé.
Et en mentionnant l’idée de l’harmonisation, plusieurs points de vue voient le jour au moment où la musique arabe se trouve exactement encastrée entre le besoin d’innover et le devoir de conserver les traditions. Ces points de vue sont très innombrables et souvent contradictoires. En effet, les uns disent que la nature de l’échelle modale ne s’harmonise pas, étant donné que l’harmonie a été primitivement conçue pour habiller et accompagner une ligne mélodique d’origine tonale. Et ici, on se souvient rapidement de la démarche qualitative que l’aspect tonal a subi depuis sa délibération de la rigueur carrée et les fonctionnalités néanmoins stagnées de l’échelle modale grégorienne.
C’était ce qui devrait être observé dans la supposition offerte par ce point de vue qui pourtant se considère, selon notre propre vision, comme un raisonnement logique. Tout de même, nous avons découvert une autre hypothèse qui est aussi bien rationnelle que la précédente. Elle confirme le fait que le maqam est une extension sonore de la tonalité, ce qui veut dire que même si l’harmonie n’a pas été précédemment inspirée par une construction mélodique modale, l’adaptation de ce langage originellement monophonique aux exigences imposées par la loi harmonique (et on n’oublie pas que cette loi a été conformément conçue pour servir la tonalité) est absolument possible.
Face à ces deux points de vue différents, la possibilité d’harmoniser une mélodie modale ou maqamique n’est pas tout à fait absurde. Cette suggestion est largement confirmée aujourd’hui, car on remarque une attention accrue par les faiseurs (ou compositeurs-arrangeurs ?!) et les consommateurs (ou auditeurs non avertis d’une musique devenant de plus en plus commerciale) de la musique arabe moderne à l’aspect harmonique et polyphonique de n’importe quelle mélodie, dans n’importe quel style. Toutes ces modifications et transformations techniques de l’allure monodique de l’échelle modale sont élaborées sous le titre de l’innovation.
Ceci semble être tout à fait tolérable, puisque le monde et l’époque que nous vivons exigent une instabilité quasi permanente dans toutes les conventions et les conceptions prises dans n’importe quel domaine, et principalement celui de la musique. En d’autres termes, les produits et les idées artistiques médiatisés ne sont plus contraintes à une durabilité sur laquelle on peut construire certaines constantes dogmatiques, afin de donner à l’œuvre d’art un sens et surtout une permanence. Cette continuité pourrait devenir le point de départ d’une autre construction sur un modèle existant et ainsi de suite.
Dhia Eddine ben Youssef
Ajouter un commentaire